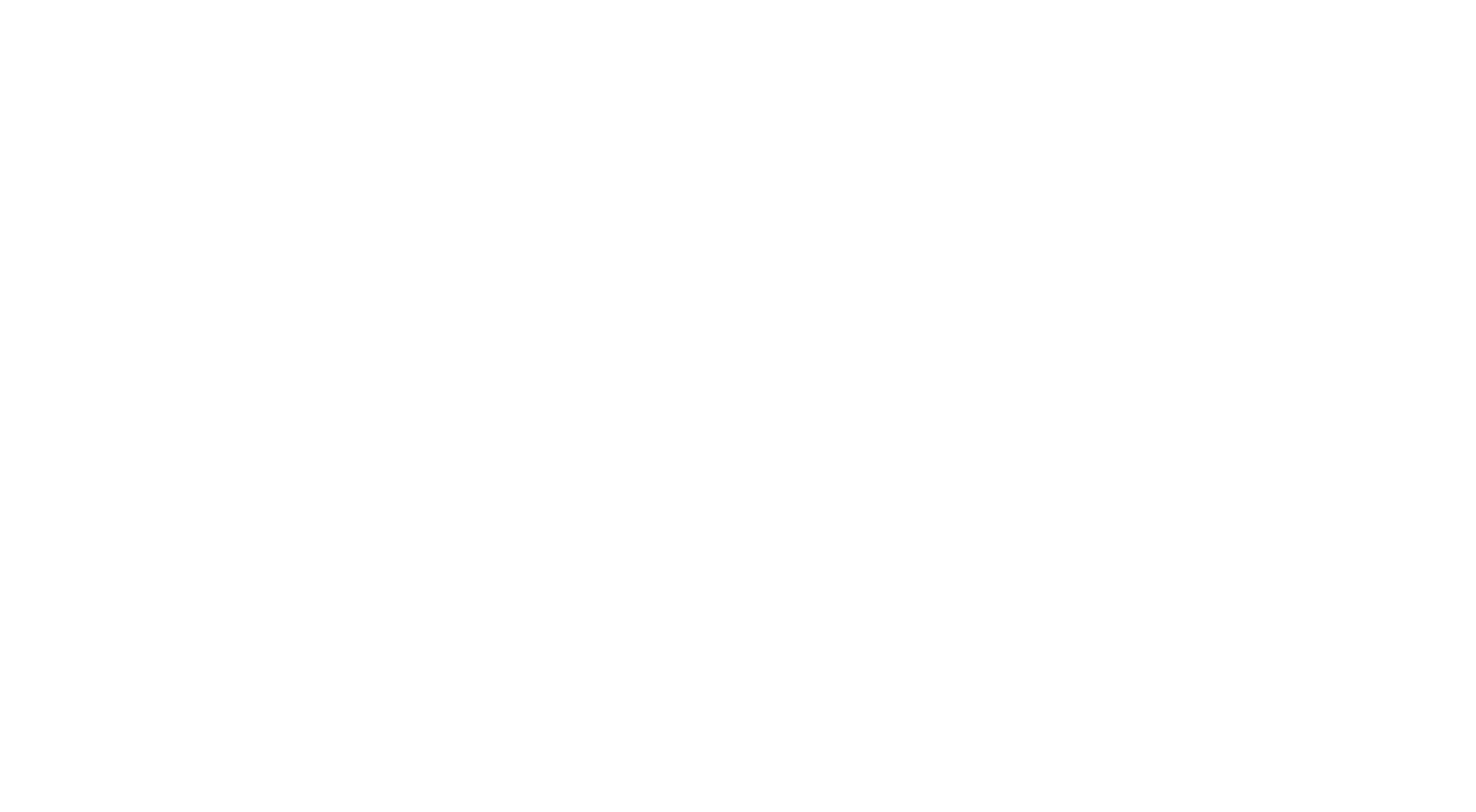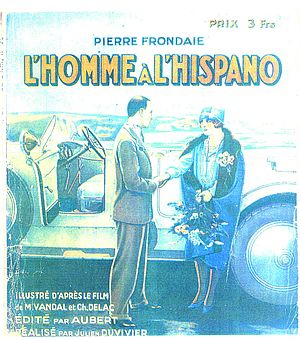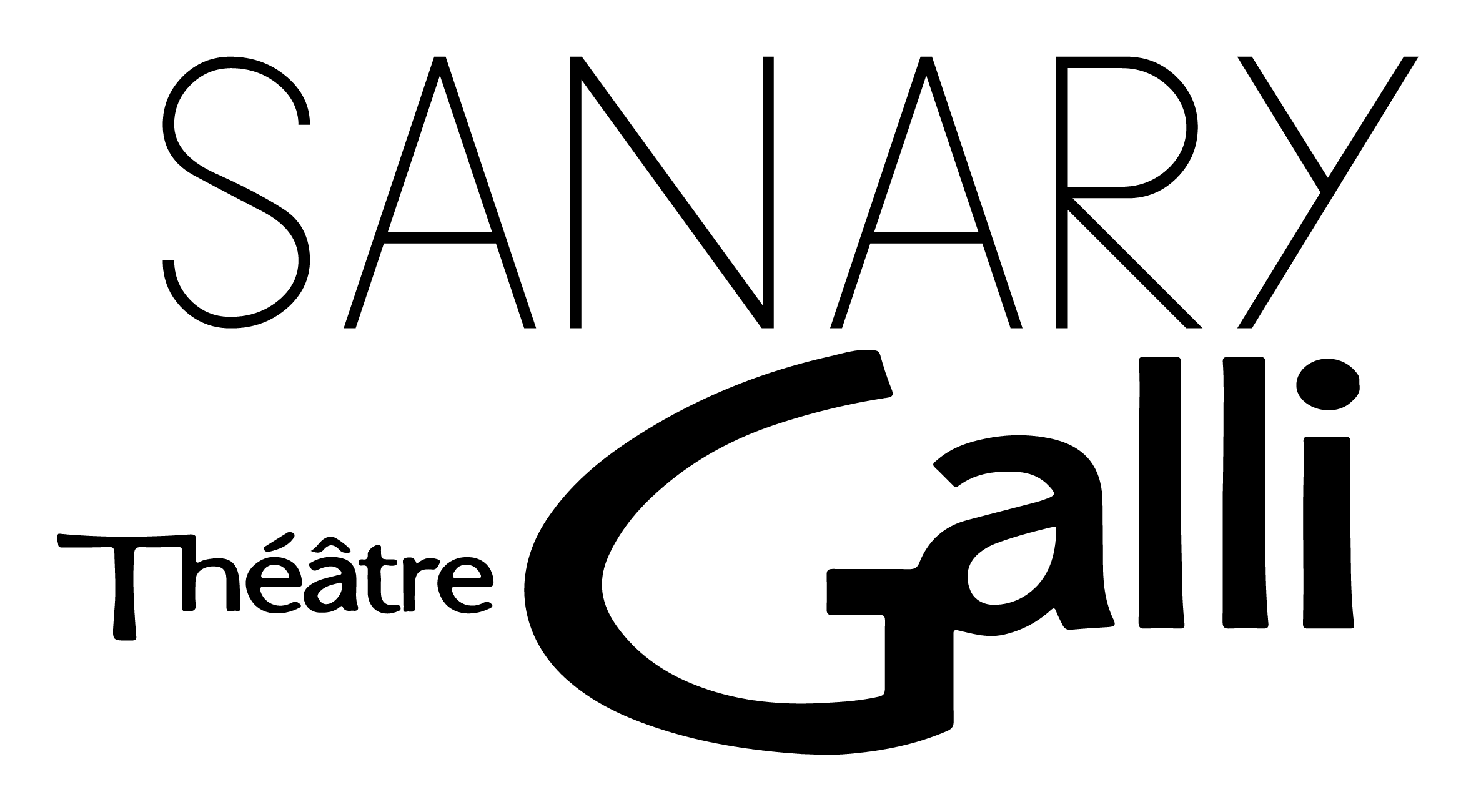DE LA CITé DE LA JEUNESSE AU THéÂTRE GALLI :
LA VOLONTé D’UN HOMME AU PARCOURS EXCEPTIONNEL
Georges Henri Nicolas Galli, né le 24 novembre 1902 à Aix-les-Bains, d’une modeste famille italienne, est le fils de Marie née Versari, modiste — dont la belle-sœur Anna Versari avait des attaches à la cour de Belgique — et de Domenico Galli, employé de commerce, originaire de Vezzo, dans la province de Nouare. De sa mère, il hérite la finesse et la bonté ; de son père, le dynamisme et un sens profond des réalités. Il passe sa jeunesse à Nice, étudie au lycée de Masséna, puis à l’Institut Lavoisier, avant de poursuivre des études de droit à Paris.
Passionné de théâtre, de sport et de cinéma, Georges Galli fréquente régulièrement les salles obscures. Un jour, il entre dans un cinéma des boulevards où est projeté La Flamme de René Hervil. C’est une révélation : il comprend toute la beauté du 7ème art. Son diplôme en poche, il s’inscrit au Barreau et devient avocat pour la firme de production américaine Metro-Goldwyn-Mayer. Un jour, un ami l’emmène assister à une prise de vues aux studios du Film d’Art à Neuilly, et lui propose d’y faire de la figuration. C’est le début d’une nouvelle aventure.
Par un concours de circonstances, il est choisi par Nadal et Julien Duvivier pour incarner Georges Dewalter dans L’Homme à l’Hispano (1926), adaptation du roman de Pierre Frondaie. Le film connaît un succès retentissant et fait de lui, du jour au lendemain, un jeune premier en vogue. Son charme, son élégance et son talent lui valent de côtoyer les plus grands : Jean Marais, Arletty, Mary Marquet, Henri Garat, Jean Weber, Roland Toutain ou encore Robert Pizani.
Entre 1927 et 1929, il part en Angleterre, attiré par le succès et l’image romantique du « french mari ». Il y tourne cinq films, dont Les Bas Jaunes et La Mélodie Inachevée réalisés par Fred Paul. Suivront Un soir au Cocktail’s Bar en 1929 et La nuit est à nous de Roger Lion en 1930. Le cinéma, les palaces, les Cadillac… Georges Galli vit quatre années dans cet univers étincelant.
Cependant, le 15 août 1929, lors d’une messe à la chapelle du French Hospital à Piccadilly, un bouleversement intérieur l’ébranle profondément : la vocation ecclésiastique s’impose à lui. Il a 27 ans. À Noël 1929, il disparaît sans explication, laissant simplement un mot : « Je pars pour une autre vie. Je vous écrirai plus tard. Oubliez-moi, je tâcherai d’être un autre. » Il dira plus tard n’avoir été « qu’une étoile filante ». Il trouve refuge dans un séminaire en Hollande (et non en Belgique, comme il le fait croire à certains), où il demande asile pour cette nouvelle vie, si calme, si différente.
En 1933, il est admis dans la congrégation des Rédemptoristes, un ordre mineur, en qualité d’acolyte. Il y reste deux ans, subissant des épreuves particulièrement difficiles pour éprouver la solidité de sa foi. Nombreuses sont les portes qui lui sont alors fermées : missions étrangères refusées, nomination dans un séminaire bloquée… Prêt à renoncer, il fait une prière devant l’autel, demandant à Dieu de le retenir s’Il veut de lui. Au moment de quitter l’église, une force mystérieuse le pousse à revenir à l’autel : son destin est scellé.
Il est ordonné prêtre dans le couvent des moniales de Saint-Maximin le 13 février 1938. Il desservira d’abord plusieurs paroisses dans les Alpes et le Var. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en pleine occupation et sous les bombardements, il refuse de quitter sa paroisse malgré les risques. En 1944, il est envoyé à Paris pour organiser l’aide aux réfugiés.
En juillet 1947, l’abbé Galli succède aux chanoines Arnaldi et Cathala à Sanary. Il devient titulaire de la paroisse le 23 février 1950, après le décès tragique de l’abbé Cathala dans la Sainte-Baume. À son arrivée, il découvre une communauté spirituellement préparée, mais un patrimoine matériel abîmé par la guerre : l’église et la chapelle de la Pitié à restaurer, la chapelle de Coquillon à remettre au culte…
Son grand souci : la jeunesse. Dès 1949, il obtient du maire un terrain communal pour y construire un centre regroupant les œuvres paroissiales, le scoutisme et les activités sportives. Il rêve alors d’une Cité de la Jeunesse : un vaste complexe de plus de 3000 m² dédié à la culture, au sport, au théâtre, au cinéma, au jeu et à la transmission de valeurs. Il plante symboliquement un poteau avec l’inscription : « Ici sera construite la Cité de la Jeunesse. » Il engage ses propres fonds, mobilise les dons locaux, nationaux et internationaux, et obtient un soutien de l’État.
Le chantier est confié à l’architecte Linossier. La pierre de Rognes est choisie pour sa noblesse et sa symbolique romaine. Le 8 mai 1957, Monseigneur Gaudel vient poser la première pierre. Le 28 juin 1959, Maurice Herzog, Haut Commissaire à la Jeunesse, inaugure la première Cité de la Jeunesse jamais construite en France. Dans les années 1960, près de 2000 personnes assistent à des spectacles, compétitions ou projections dans ce lieu devenu emblématique. Il lègue la Cité à la Ville en 1978 afin qu’elle reste vivante et accessible aux Sanaryens.
En 1970, l’évêché de Toulon le met à la retraite, mais il continue à célébrer la messe chaque matin à la chapelle Notre-Dame de Pitié, avec le frère Jules. Sa renommée dépasse les frontières du département. Acteur, prêtre, chanoine, Georges Galli est fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1970, reçoit la Palme d’Or de l’Accueil et du Tourisme en 1977, et est élu le 5 mars 1980 à l’Académie du Var, au fauteuil n°43.
Il s’éteint le 3 juillet 1983 à l’hôpital de la Conception à Marseille. Ses obsèques sont célébrées dans la Cité de la Jeunesse — rebaptisée Théâtre Georges Galli — devant une foule émue et silencieuse, témoignant de l’empreinte indélébile de celui que l’on appelait avec tendresse le bon curé de Sanary.